
Si le mouvement #Meetoo a permis de libérer la parole, elle reste toujours sujette à caution, estime l’ancienne ministre Najat Vallaud-Belkacem dans une tribune au « Monde ». S’appuyant sur une enquête d’Ipsos, elle montre que le relativisme qui imprègne encore les sociétés occidentales demeure un frein pour éradiquer ce fléau.
Triste rendez-vous que ce dimanche 25 novembre, comme chaque année, sur le calendrier, impassible et sinistre, des violences quotidiennes faites aux femmes. Qui jamais ne semble devoir s’interrompre. Dans notre pays, tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint ; toutes les sept minutes, une autre subit un viol ; tous les ans, 200 000 sont victimes de violences physiques et sexuelles.
Et si ces chiffres ne suffisent pas à eux seuls à dire la permanence de l’horreur, alors observons un peu plus loin l’imagination sans borne de sociétés violentes, jusqu’à la nausée, à l’égard toujours des mêmes. On savait les mutilations génitales, les mariages précoces, la prostitution, et autre « panoplie » de souffrances imposées aux femmes. On dit moins les pratiques « traditionnelles » sous couvert de « culture » qu’il faut savoir combattre avec la même détermination que nous avons combattu l’excision : ces veuves à qui l’on impose encore de dormir avec le corps du défunt et de boire l’eau avec laquelle on a lavé son corps ; ces jeunes femmes violées contraintes d’épouser leur agresseur ; ces filles à la fertilité testée par des inconnus avant d’être autorisées à se marier…
Il n’y a place ni pour le relativisme ni pour la condescendance en la matière. Et si toutes les violences ne se ressemblent pas, la tolérance sociale, principale alliée du scandale, continue d’exister là-bas comme ici.
Comme sur une autre planète, il faut entendre depuis plus d’un an certains commentateurs s’émouvoir qu’on « aille trop loin dans le grand déballage #meetoo ». Perception spontanée ou impactée par ces propos à l’emporte-pièce ? Voilà que, selon une étude récente effectuée par Ipsos, un homme français sur cinq, et un homme américain sur trois, pense en effet que les femmes « exagèrent souvent les cas de viol ou de violences » qu’elles rapportent.
La parole se libère certes, pas toujours les oreilles et les yeux de celles et de ceux qui ne mesurent pas la dureté de cette violence quotidienne et tristement ordinaire. Ni des chaînes d’informations en continu qui, trop occupées à couvrir les faits d’armes de casseurs sur les Champs-Elysées, en oublient purement et simplement d’évoquer une manifestation pourtant massive le même jour pour dénoncer ces violences.
Ainsi nous serions allés trop loin dans le déballage ? Vraiment ? Observons la réalité crue pour changer. Que nous dit-elle ? Qu’en dépit des progrès indéniables de la loi, de l’implication des professionnels, des numéros d’urgence mis en place, le jour espéré où il suffira qu’une violence faite à une femme, en particulier dans un cadre familial, soit connue, pour qu’elle cesse immédiatement sous la réprobation générale de l’entourage, des témoins indignés, est loin d’être arrivé.
D’abord parce que dans nos perceptions communes, la véritable gravité de ces diverses violences est encore sujette à caution. Près d’un Français sur trois pense, par exemple, que la plupart des agressions sexuelles cesseraient si la femme concernée disait simplement à son agresseur de s’arrêter ; un Américain sur cinq estime qu’une « bonne épouse obéit à son mari, même si elle n’est pas d’accord » et que les relations sexuelles non consenties font partie des obligations d’une épouse à l’égard de son mari ; une personne sur cinq, dans un échantillon de vingt-sept pays (comptant la plupart des pays européens, mais aussi les Etats-Unis, le Canada, le Mexique, la Chine, ou encore l’Afrique du Sud), estime tout simplement que « les femmes sont inférieures aux hommes ».
Ensuite, parce que leur dimension intime fait, encore et toujours, obstacle à l’idée d’une intervention extérieure, toujours vécue comme une immixtion dans la vie privée. Ainsi, confronté à une amie subissant des violences conjugales, seul un Français sur deux déclare qu’il irait rapporter les faits aux autorités (46 % des Américains, et seulement 33 % des Britanniques). On mesure les conséquences potentielles lorsque 41 % des femmes françaises, 43 % des femmes britanniques, et même 55 % des femmes américaines, disent connaître personnellement une femme ayant été victime de violences.
Il serait grand temps que cette réticence pudique, que chacun peut en effet légitimement ressentir, laisse place à la conscience plus forte que la violence n’est ni plus acceptable ni moins douloureuse parce qu’elle s’exerce dans l’intimité, et suivie, parfois, d’excuses. Qu’au contraire, ce type de contexte la rend d’autant plus grave qu’il signifie qu’elle sera répétée, régulière, croissante et doublée d’une emprise psychologique destructrice pour les femmes concernées, sans parler des conséquences irréversibles pour les enfants témoins – quand ils ne sont pas eux-mêmes directement victimes des coups.
Alors comment agir pour faire progresser nos réflexes respectifs de ce point de vue ? En parler. N’en déplaise à ceux qui croient sérieusement qu’on en fait trop sur ces sujets. L’ampleur de ce qu’il reste à accomplir pour abattre la tolérance culturelle est telle que seule la verbalisation permet d’en prendre conscience. De ce point de vue, #metoo fut un formidable souffle qu’il faudra continuer à entretenir afin que la parole se libère. A condition cependant que cette parole n’aille pas s’échouer lamentablement sur l’absence de réponses légales, juridiques, institutionnelles.
Car la troisième explication de l’insuffisant coup d’arrêt donné à temps à chaque situation de violence connue, réside dans la défiance et la suspicion éprouvée, par les victimes comme par les témoins, quant à la capacité des institutions (police, justice, pouvoirs publics) à véritablement apporter des solutions : répondre aux coups de fils affolés autrement que par une simple leçon de savoir vivre à Monsieur, traiter les plaintes autrement qu’en les classant sans suite ; faire appliquer les lois telles qu’elles existent et dans les temps requis, et notamment, s’agissant de la France, celle sur l’éviction du domicile du conjoint violent ou encore sur l’ordonnance de protection ; tenir la promesse que des hébergements d’urgence soient vraiment accessibles et donc créés en nombre suffisant…
Rien de cela ne semble une certitude pour les citoyennes et c’est ainsi qu’en France, comme au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis, seulement une petite minorité des répondants (une personne sur trois) estime qu’une femme portant plainte contre un conjoint violent peut avoir confiance dans les autorités et le système judiciaire.
Alors une question : Si, vraiment, nous autres citoyens, considérons les institutions défaillantes à ce point, et sur un sujet aussi grave, pourquoi l’accepter ?
Pourquoi manifester si peu de soutien public aux associations qui chaque jour – et pas seulement le 25 novembre – militent pour faire changer et appliquer la loi, dénoncent les moyens ou les formations insuffisantes de services publics indispensables (police, justice, services sociaux), refusent le silence et la résignation ? Ce sont elles les porte-voix des murmures de nos milliers de confidentes.
Najat Vallaud-Belkacem – Directrice générale Affaires internationales, Groupe Ipsos
Photo : © RazakParis – Manifestation NousToutes, le 24 novembre 2018.
Sur le même sujet
-
 A Mont-de-Marsan pour renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes
A Mont-de-Marsan pour renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes
-
 Violences faites aux femmes : Service du 3919 étendu & rendu gratuit
Violences faites aux femmes : Service du 3919 étendu & rendu gratuit
-
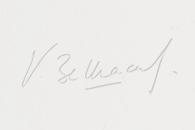 «Les violences faites aux femmes sont tristement banales»
«Les violences faites aux femmes sont tristement banales»