
Biais d’optimisme, excès de confiance ou de conformisme qui influe sur leurs décisions, les décideurs politiques n’en sont pas exempts. C’est ce que rappelle l’ancienne ministre et désormais, directrice générale « Global Affairs » chez Ipsos, Najat Vallaud-Belkacem. Dans cette tribune, elle appelle les leaders politiques à un exercice d’introspection.
Les sciences cognitives et sociales nous ont apporté, au cours des dernières années, un degré de compréhension formidable des raisons profondes de nos prises de décision, et des facteurs qui influencent nos comportements à notre insu. Bien qu’en France, les expériences visant à employer les sciences comportementales pour concevoir et évaluer les politiques publiques restent encore à échelle limitée, il suffit de prendre du champ pour observer qu’ailleurs une meilleure compréhension des comportements individuels et des biais cognitifs les entourant permet aux pouvoirs publics de faire gagner en efficacité à leurs politiques de sécurité routière, de santé publique ou de protection de l’environnement.
Nous sommes donc de plus en plus au fait de la manière dont fonctionne notre cerveau de citoyen comme de consommateur, et pourtant… pourtant, nous nous interrogeons rarement sur les multiples biais cognitifs individuels et dynamiques collectives qui influencent les “décideurs” eux-mêmes. Manque d’humilité ? Conviction qu’il existerait une sorte d’infaillibilité des élites, comme il existe un dogme d’infaillibilité pontificale ? Faire l’ENA ou les grandes écoles nous immuniserait donc contre les biais plus ou moins conscients et autres erreurs de jugement ? Pourtant l’histoire regorge de décisions allant à l’encontre des savoirs établis, ou prises à contretemps ou inapplicables…
Plus nous croyons en quelque chose, plus nous avons tendance à surestimer la part de la population globale qui partage nos vues
C’est avec ces interrogations en tête que j’ai découvert une initiative récente du gouvernement britannique visant à comprendre les biais des leaders politiques, et à offrir des moyens d’y remédier, et donc de « mieux décider ». Ce rapport mérite une lecture approfondie, et j’ose espérer que d’autres gouvernements ont suivi la même démarche et qu’il ne s’agit pas d’un cas unique, mais laissez-moi vous en citer quelques extraits, pour vous convaincre de son importance :
- La manière dont nous percevons les sujets influence fortement les réponses que nous y apportons : nous tendons à opter pour des solutions plus radicales et risquées si l’on nous présente un problème sous l’angle des morts potentielles, plutôt que de vies potentiellement sauvées (donc on réagira à un accident de car meurtrier, mais on peinera à être aussi ambitieux s’il s’agit de faire baisser les statistiques annuelles des accidents de la route)
- Lorsqu’une décision fait l’objet d’une délibération, comme la décision britannique d’envoyer des troupes en Irak, certaines dynamiques peuvent conduire ceux qui ne sont pas d’accord avec la majorité à se taire – par conformisme -, et des positions extrêmes, éloignées du centre de gravité du groupe, peuvent in fine être adoptées.
- Nous tendons à penser que les autres partagent nos opinions – plus nous croyons en quelque chose, plus nous avons tendance à surestimer la part de la population globale qui partage nos vues. Ce qui pose évidemment des problèmes, surtout lorsqu’un décideur détient beaucoup de pouvoir, et que les contrepouvoirs sont relativement faibles (suivez mon regard).
- Enfin, nous sommes tous en proie à un biais d’optimisme – et les leaders politiques n’y échappent pas. Le taux de divorce est, dans le monde occidental, de 40%. Pourtant, si vous demandez à de jeunes mariés quelle est la probabilité de leur propre divorce, ils l’estiment – évidemment – à zéro. Dans le cas qui nous occupe, ce biais d’optimisme conduit les élites et responsables publics à surestimer l’efficacité d’une décision prise, et leur capacité à atteindre un objectif donné. Une étude récente menée aux Etats-Unis a ainsi démontré que plus les décideurs interrogés étaient expérimentés, plus ils avaient tendance à surestimer leur niveau de connaissances et leurs capacités.
La délibération collective n’amène pas nécessairement à une « bonne » décision et notre cerveau n’est par défaut pas programmé pour penser le long terme
Ce ne sont ici que quelques exemples, qui pourraient paraître anecdotiques ou que l’on pourrait accueillir avec résignation, si derrière chacun de ces biais et de ces imperfections, il n’y avait pas des vies, des destins dont le cours pourrait changer.
Il existe d’ores et déjà un très grand nombre de travaux de recherche qui explorent les multiples manières dont nos processus décisionnels peuvent conduire, sinon à des catastrophes, du moins à des décisions bien en deçà de l’optimalité au regard de l’intérêt général. Par exemple, Tali Sharot, professeure en neurosciences cognitives, en psychologie et en neurosciences à l’université de Londres, a très bien décrit dans Usbek & Rica la manière dont la délibération collective n’amène pas nécessairement à prendre une « bonne » décision, ou bien comment notre cerveau n’est par défaut pas programmé pour penser le long terme.
Parce que l’enjeu collectif est si grand, et parce que l’état des connaissances et de la recherche nous le permet, il est plus que temps d’engager l’ensemble des institutions – gouvernementales, et supranationales – qui sont amenées à peser sur les décisions collectives dans un exercice d’introspection et de prise en compte de l’ensemble des biais décisionnels. Cela suppose, évidemment, que les leaders en question disposent d’une dose suffisante d’humilité. Celle qui fait les femmes et les hommes d’Etat.
Cet article est d’abord paru le 20 septembre 2019 dans la revue Usbek et Rica
Sur le même sujet
-
 Je veux saluer la décision d’un homme d’État, qui a toujours fait passer l’intérêt de la Nation avant sa personne
Je veux saluer la décision d’un homme d’État, qui a toujours fait passer l’intérêt de la Nation avant sa personne
-
 Le redoublement devient une décision exceptionnelle, prise en accord avec les parents
Le redoublement devient une décision exceptionnelle, prise en accord avec les parents
-
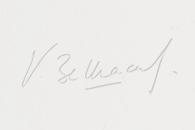 «La meilleure façon pour un impôt d’être juste, c’est d’être progressif»: l’intégralité de mon chat’ pour 20 minutes.
«La meilleure façon pour un impôt d’être juste, c’est d’être progressif»: l’intégralité de mon chat’ pour 20 minutes.